
Le bilan orthophonique est au cœur de notre pratique professionnelle, quel que soit l’âge de nos patients. Il s’agit de l’étape fondamentale qui nous permet de mesurer et d’évaluer les potentialités et les déficits d’un patient présentant des troubles du langage et/ou cognitifs.
Mais qu’englobe exactement cet acte, et comment les recommandations actuelles, notamment en matière de terminologie, façonnent-elles notre approche ?
Qu’est-ce qu’un Bilan Orthophonique ?
Réalisé exclusivement par l’orthophoniste sur prescription médicale, le bilan orthophonique est un outil clinique de diagnostic.
Il débute classiquement par un entretien avec anamnèse, recueillant l’histoire du patient, ses difficultés et les inquiétudes de l’entourage.
Vient ensuite la passation d’épreuves standardisées et/ou d’outils d’observation clinique (BO Bulletin officiel n°32 du 5 septembre 2013), dont les résultats sont analysés et interprétés pour aboutir à un diagnostic et à un projet thérapeutique.
À l’issue de ce bilan, nous avons l’obligation de rédiger un compte rendu. Ce compte rendu de bilan orthophonique est adressé au médecin prescripteur et, le cas échéant, aux parents qui peuvent y avoir accès. Il doit mentionner le diagnostic orthophonique établi.

L’Évolution de la terminologie : La clé de notre expertise
Notre profession, jeune et en constante évolution, se situe au carrefour de multiples domaines. Pour assurer une communication claire et précise entre professionnels et valoriser notre expertise, il est crucial d’utiliser une terminologie harmonisée. C’est le rôle de la « Charte terminologique ».
Cette charte s’appuie sur plusieurs références reconnues internationalement et nationalement : la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) pour la cotation administrative, le DSM-5, la CIM 11, le consensus Catalise, et les Recommandations de bonne pratique (notamment pour le langage écrit).
L’évolution de la terminologie est notable :
- Pour les troubles du langage oral, les anciennes appellations comme dysphasie, retard de parole ou de langage tendent à être remplacées par les termes du consensus Catalise : Trouble des Sons de la Parole (TSP), Trouble Développemental du Langage (TDL), ou Trouble du Langage (TL) (avec justification étiologique).
- Concernant les troubles du langage écrit, autrefois regroupés sous dyslexie ou dysorthographie, les références actuelles (DSM-5, CIM 11, recommandations CFO) emploient les termes de Troubles Spécifiques des Apprentissages (TSAp) ou Troubles Développementaux de l’Apprentissage, et plus spécifiquement pour notre domaine, Trouble Spécifique du Langage Écrit (TSLE sCO « sans trouble de la compréhension orale » / TSLE aCO « avec trouble de la compréhension orale ») ou Trouble du Langage Écrit (TLE). Ces troubles affectent la lecture et/ou l’orthographe.
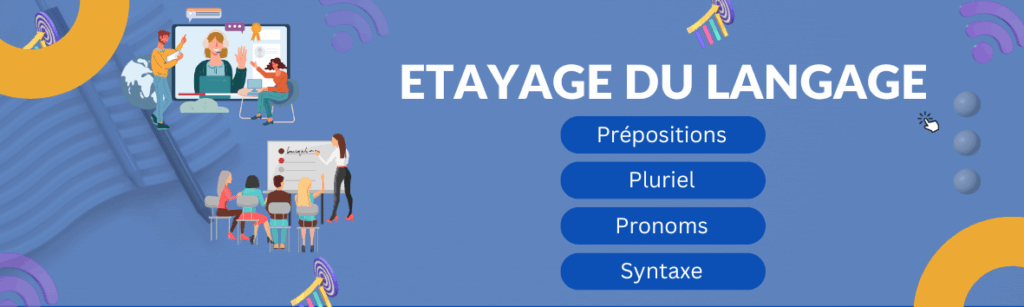
Focus sur les Troubles de la Cognition Mathématique
La cognition mathématique ne se limite pas au simple calcul, mais englobe aussi la capacité de raisonner et d’établir des relations entre objets abstraits.
Les troubles de la cognition mathématique affectent les structures logiques et numériques. Ces troubles, qui incluent la dyscalculie et les troubles du raisonnement logico-mathématique, font l’objet d’un bilan orthophonique spécifique, parfois familièrement désigné comme un bilan logico-mathématique orthophoniste.
Lors de ce bilan des troubles de la cognition mathématique, nous explorons divers domaines :
- Les activités infra-logiques (organisation, planification).
- Les préalables au nombre et aux problèmes arithmétiques.
- Le concept de nombre et la numération.
- Les problèmes arithmétiques et les conduites de combinatoire logique.
- Les conduites classificatrices et les conduites de mise en relation logique.
Des difficultés dans ces domaines peuvent se manifester par des erreurs de transcodage, comme lire « mille trente-deux » et écrire « 100032 ». La rééducation s’appuie sur le raisonnement logico-mathématique du patient et utilise le travail déductif.
Dans ce champ spécifique, la NGAP conserve pour le moment le libellé « trouble de la cognition mathématique », couvrant les troubles du calcul et du raisonnement. La nouvelle terminologie proposée par Launay. L, Helloin M.-C. Lartot-Pierquin. V. Roch. D. (2022) est le TSAM (Trouble Spécifique des Apprentissages en Mathématiques) pour différencier un trouble spécifique d’un Trouble des Apprentissages non Spécifique en Mathématiques (TAM).
Les composantes évaluées lors du bilan orthophonique
De manière plus générale, un bilan orthophonique complet peut examiner de multiples aspects du langage et des compétences associées :
- Les praxies buccofaciales.
- L’articulation et la phonologie, incluant le trouble phonologique.
- Le lexique (réceptif et expressif).
- La syntaxe et la morphosyntaxe.
- L’expression verbale.
- Le langage écrit (lecture et transcription/orthographe).
- Les notions temporelles et spatiales.
- La pragmatique (utilisation fonctionnelle du langage).
L’analyse précise des résultats, utilisant des normes de référence, permet de spécifier la présence ou non d’un trouble neurodéveloppemental.
Une démarche pluridisciplinaire
Il est important de rappeler que le bilan orthophonique s’inscrit souvent dans une évaluation plus large. Le langage interagit avec d’autres fonctions cognitives.
L’orthophoniste peut suggérer des examens complémentaires, tels qu’un bilan ORL, une évaluation de la vision, un bilan psychomoteur ou un entretien psychologique, si jugé nécessaire pour le diagnostic différentiel. Un bilan psychométrique n’est pas systématiquement obligatoire pour poser notre diagnostic.
En conclusion
Le bilan orthophonique est un acte fondamental qui guide toute notre intervention. L’obligation de rédiger un compte rendu précis et l’utilisation d’une terminologie harmonisée, s’appuyant sur les classifications et recommandations actuelles (DSM-5, CIM 11, Catalise, …), renforcent notre expertise et améliorent la collaboration avec les autres professionnels.
Que ce soit pour les troubles du langage oral, les troubles du langage écrit, ou les troubles de la cognition mathématique et du raisonnement logico-mathématique, cette rigueur terminologique est essentielle pour le bien-être et le parcours de soin de nos patients.
Sources :
Brin-Henry, F., & Knittel, M.-L. (2021). De qui parle-t-on — et comment — dans les bilans orthophoniques ? Dans Nommer l’humain : Descriptions, catégorisations, enjeux. Éditions Lambert-Lucas.
Chauvin, D. (2016). Bilan orthophonique. Dans P. Mazet, J. Xavier, J. Guilé, M. Plaza & D. Cohen (Éds), Troubles intellectuels et cognitifs de l’enfant et de l’adolescent : Apprendre • Connaître • Penser (pp. 153–159). Lavoisier.
Collège Français d’Orthophonie, Fédération Nationale des Orthophonistes & UNADREO. (2022). Recommandations de bonne pratique d’évaluation, de prévention et de remédiation des troubles du langage écrit chez l’enfant et l’adulte : Méthode : recommandations par consensus formalisé. Collège Français d’Orthophonie.
L’ORTHOPHONISTE N°437 (2024). Charte terminologique.

Rééducation du raisonnement et langage élaboré : Pourquoi choisir la formation Logique et Langage des enfants et adolescents ?
La rééducation du langage élaboré cible les difficultés de raisonnement inférentiel, évitant que l’adolescent ne s’arrête dès que le discours devient trop abstrait. Grâce à l’étayage langagier (Bruner), l’orthophoniste organise le support de communication pour restreindre la complexité des tâches. L’enjeu est de maîtriser le langage informatif pour faciliter le passage crucial des opérations concrètes aux opérations formelles (Tourrette & Guidetti, 2018). Ce programme fournit des outils transférables pour soutenir la compréhension du langage tant sur le versant expressif que réceptif.

DPC 2026 pour les orthophonistes : nouveaux forfaits et transition de l’Agence nationale du DPC
L’Agence nationale du DPC fermera ses portes en 2027, mais le financement est garanti pour toute l’année 2026. Profitez-en pour valider votre obligation triennale avant la transition administrative prévue.
Forfaits 2026 pour les orthophonistes libéraux :
• Volume : 14 heures/an.
• Formation Continue (FC) : 43 €/h (frais pédagogiques) + 52 €/h (indemnisation).
• EPP/GDR : 51,60 €/h + 52 €/h.
Conditions de paiement :
• Suivi intégral obligatoire : Toute absence (notamment à la première demi-journée) annule l’indemnisation.
• Inscription sécurisée : Vous devez vous inscrire personnellement sur le portail de l’ANDPC. Confier vos identifiants à un organisme tiers est strictement interdit et vous expose à des sanctions pour complicité de fraude.
Anticipez dès maintenant vos formations pour bénéficier d’un financement maîtrisé avant la disparition de l’Agence.
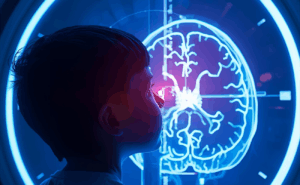
Le raisonnement logique en mathématique : des preuves interventionnelles récentes confirment le rôle causale des compétences logiques sur le développement du nombre
Cet article aborde le rôle causal des compétences d’ordre (ordinalité), confirmé par les preuves interventionnelles récentes (Morsanyi et al., 2024) montrant que l’entraînement à l’ordre numérique et à l’ordre des événements quotidiens (non numérique) entraîne une augmentation importante des compétences mathématiques formelles.
De plus, le raisonnement logique, essentiel pour l’intégration des relations, est altéré chez les enfants ayant des difficultés mathématiques, comme en témoigne la performance réduite dans les inférences transitives et l’activité neurale plus faible observée dans le Sillon Intrapariétal (SIP) lors du traitement de ces relations (Schwartz et al., 2018).

