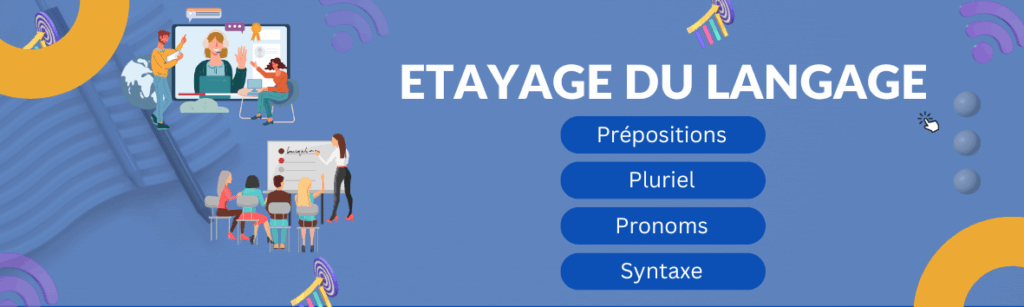Le point sur les Troubles de la Cognition Mathématique : De la dyscalculie au TSAM, pourquoi l’absence de consensus les distingue des autres troubles dys ?
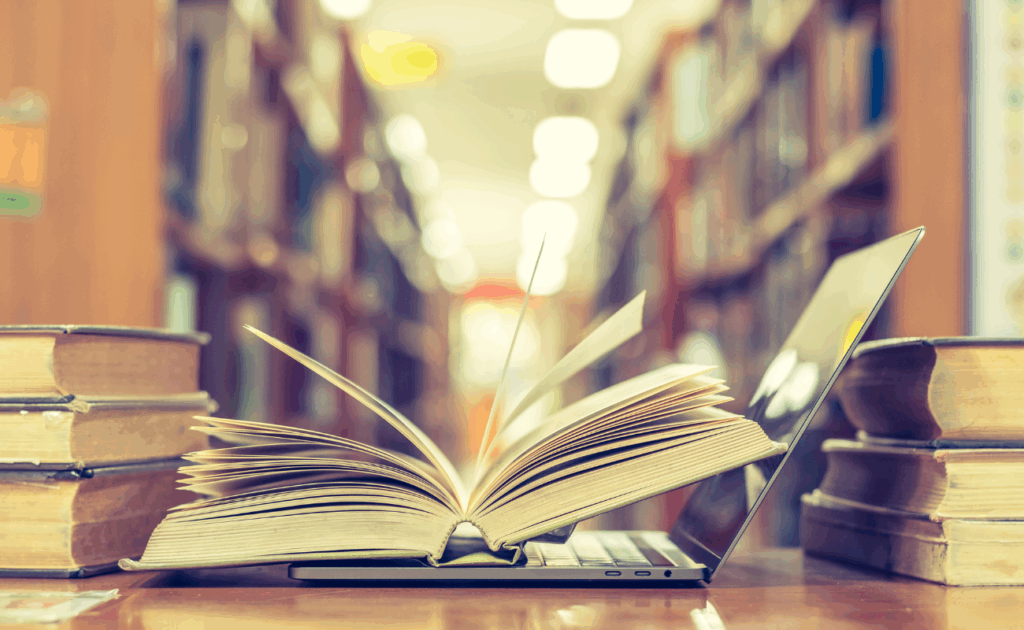
Les nombres et les mathématiques jouent un rôle fondamental dans notre société. Pourtant, de nombreux élèves, y compris en France, rencontrent des difficultés dans ce domaine, comme le soulignent les enquêtes internationales (TIMMs, PIRLS, PISA) et les évaluations nationales.
Face à ces défis, les orthophonistes sont des acteurs clés dans l’identification et la prise en charge de ces difficultés d’apprentissage. Cependant, la terminologie utilisée pour décrire ces troubles a évolué au fil du temps, reflétant les avancées de la recherche et les changements dans les classifications internationales et les pratiques professionnelles. Explorons cette évolution, de la « dyscalculie » au « trouble spécifique des apprentissages en mathématiques » (TSAM), en passant par la « cognition mathématique ».
La dyscalculie : Un terme historique aux contours variables
Le terme « dyscalculie » est apparu dans les années 1970 pour décrire les dysfonctionnements liés à la logique, la construction des nombres, les opérations, la structuration du raisonnement et l’utilisation des outils logiques et mathématiques. Il concerne souvent des enfants, adolescents ou adultes qui ne présentent pas de déficit intellectuel global. Les difficultés associées à la dyscalculie peuvent être électives (isolées en mathématiques) ou plus aiguës dans le cadre de troubles scolaires plus généraux. Elles peuvent être liées à divers facteurs, y compris une pédagogie inadaptée, des causes affectives, ou des faiblesses dans la construction des structures de pensée fondamentales comme la classification, la sériation ou la conservation, notions souvent associées aux travaux de Piaget.
La dyscalculie est reconnue comme un trouble spécifique des apprentissages dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5). Elle est très fréquemment associée à d’autres troubles spécifiques des apprentissages, comme la dyslexie et la dysorthographie ; selon certaines études, jusqu’à près de deux tiers des élèves présentant une dyscalculie auraient des difficultés d’apprentissage en lecture, et la moitié en orthographe, d’après l’Inserm (2007).
La recherche sur la dyscalculie s’est développée avec un certain retard par rapport à la dyslexie et met en évidence que l’origine peut être en partie génétique et neurobiologique. Un déficit du « sens du nombre » – c’est-à-dire une difficulté à appréhender les quantités, à associer quantités et symboles, ou à situer les nombres les uns par rapport aux autres – est parfois considéré comme l’origine de la dyscalculie « primaire » ou « vraie ». L’Inserm (2007) souligne également des difficultés atypiques de mémorisation des faits arithmétiques. Jordan, Hanich et Kaplan (2003) décrivent quant à eux des difficultés à récupérer les faits arithmétiques en mémoire à long terme.
Malgré son usage courant, le terme « dyscalculie » peut être difficile à circonscrire précisément, car toute difficulté en mathématiques n’en relève pas forcément.
La Cognition Mathématique : Un concept plus large pour les orthophonistes
Dans le champ de l’orthophonie en France, le terme « cognition mathématique » a progressivement remplacé celui de « raisonnement logicomathématique« . Cette évolution est inscrite dans les référentiels d’activités et de formation des orthophonistes depuis leur parution au Bulletin officiel du 5 septembre 2013.
La « cognition mathématique » est un terme plus général qui regroupe l’ensemble des compétences nécessaires à l’apprentissage des mathématiques. Il intègre trois perspectives liées : l’intelligence globale, les fonctions cognitives utiles à l’acquisition des mathématiques (fonctions exécutives, mémoire, langage, compétences visuospatiales, résolution de problèmes, etc.), et les structures logiques élémentaires (classification, sériation, conservation).
Ce terme reconnaît que les difficultés d’acquisition peuvent avoir des origines variées : constitutives (déficiences intellectuelles), environnementales (scolarisation insuffisante), ou être consécutives à un déficit spécifique comme la dyscalculie. Son intitulé plus général permet de ne pas induire d’hypothèse étiologique spécifique.
La Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), qui régit la cotation administrative des actes des orthophonistes en France, a également adopté cette terminologie. Depuis le 1er avril 2018, le bilan orthophonique dans ce domaine est libellé « Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…) ».
Vers le TSAM ? L’alignement avec les classifications internationales
Les classifications internationales continuent d’évoluer. Le DSM-5 utilise l’appellation « Troubles spécifiques des apprentissages » (TSAp) pour décrire les difficultés persistantes dans l’acquisition et l’utilisation du langage oral, du langage écrit et/ou des mathématiques, qui ne sont pas mieux expliquées par d’autres facteurs. Dans le DSM-5, le trouble spécifique d’apprentissage en mathématiques se caractérise par des difficultés dans la compréhension du sens des nombres, la mémorisation des faits arithmétiques, le calcul exact ou fluide, ou le raisonnement mathématique correct. Ces difficultés doivent interférer de manière significative avec les performances scolaires.
Dans une optique d’harmonisation et pour faciliter la communication entre professionnels, des auteurs comme Launay, Helloin, Lartot-Pierquin, et Roch (2022), cités dans L’Orthophoniste (mars 2024), proposent l’utilisation du sigle TSAM (Trouble spécifique des apprentissages en mathématiques) pour distinguer clairement ce trouble d’un trouble des apprentissages non spécifique en mathématiques (TAM). Cette proposition s’inscrit dans la volonté d’utiliser des terminologies compatibles avec celles des autres disciplines, en se référant aux classifications internationales comme le DSM-5 et la CIM 11.
Il est cependant important de noter, comme le souligne L’Orthophoniste en mars 2024, que ce trouble des apprentissages en mathématiques se distingue des troubles spécifiques des apprentissages (troubles spécifiques du langage oral – TDL Trouble développemental du langage – TSLE troubles spécifiques du langage écrit) quant à l’absence de consensus dans la littérature internationale.
La NGAP : Un reflet des pratiques, mais avec un décalage temporel
La profession d’orthophoniste s’appuie sur la NGAP pour la cotation de ses actes. Cette nomenclature, bien qu’elle évolue, ne s’actualise pas toujours aussi rapidement que la recherche et les classifications scientifiques.
Actuellement, les orthophonistes conventionnés en France continuent d’utiliser le libellé « Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique…) » dans la NGAP pour leurs actes de bilan. Une publication professionnelle récente en février 2025 confirme que la NGAP « conserve » ce libellé.
En conclusion
L’évolution de la terminologie pour les difficultés en mathématiques en orthophonie reflète la complexité de cet objet d’étude. De la « dyscalculie » (terme souvent associé à des difficultés spécifiques en calcul), le champ s’est élargi avec la « cognition mathématique » (terme plus global et englobant, adopté dans les référentiels de formation et la NGAP). Aujourd’hui, le sigle TSAM est proposé et de plus en plus utilisé par certains professionnels pour mieux s’aligner sur les classifications internationales comme le DSM-5 et distinguer les troubles spécifiques des troubles non spécifiques en mathématiques. Cependant, pour l’instant, la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) des orthophonistes n’a pas encore officiellement adopté le terme TSAM et continue d’utiliser le libellé « cognition mathématique » pour la cotation des bilans. Cette différence met en évidence le décalage qui peut exister entre les avancées de la recherche, l’évolution des classifications et l’actualisation des outils administratifs.
Sources :
Billard, C., Gassama, S., Touzin, M., Mirassou, A., Munnich, A., & Thalabard, J.-C. (s.d.). Impact d’interventions pédagogiques sur les performances des collégiens souffrant de difficultés d’apprentissages en langage écrit et mathématiques. Une étude contrôlée.
Brin-Henry F., Courrier C., Lederlé E., Masy V. (2025). Dictionnaire d’Orthophonie.
Cattini, J., & Lafay, A. (2021). L’Efficacité des interventions en mathématiques chez les enfants ayant un trouble des apprentissages en mathématiques ou à risque: Synthèse narrative d’une série de revues de littérature systématiques. Glossa, 131, 87
Degiovani, S. (Éditorialiste) et divers contributeurs (2024). L’Orthophoniste, (437). [Numéro de mars 2024 du journal professionnel de la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO)].
Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) sous mandat de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de Suisse romande et du Tessin (CIIP). Dyscalculie (trouble spécifique d’apprentissage en mathématiques) à l’école régulière.
UNCAM. (2025). Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). [Version en vigueur du 01/02/2025].
UNCAM. (2025). Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). [Version en vigueur du 09/04/2025].
Van Nieuwenhoven, C., De Vriendt, S. et Hanin, V. (2019). Chapitre 2. Poser un diagnostic. L’enfant en difficulté d’apprentissage en mathématiques : Pistes de diagnostic et supports d’intervention (p. 29-50). De Boeck Supérieur.

Rééducation du raisonnement et langage élaboré : Pourquoi choisir la formation Logique et Langage des enfants et adolescents ?
La rééducation du langage élaboré cible les difficultés de raisonnement inférentiel, évitant que l’adolescent ne s’arrête dès que le discours devient trop abstrait. Grâce à l’étayage langagier (Bruner), l’orthophoniste organise le support de communication pour restreindre la complexité des tâches. L’enjeu est de maîtriser le langage informatif pour faciliter le passage crucial des opérations concrètes aux opérations formelles (Tourrette & Guidetti, 2018). Ce programme fournit des outils transférables pour soutenir la compréhension du langage tant sur le versant expressif que réceptif.

DPC 2026 pour les orthophonistes : nouveaux forfaits et transition de l’Agence nationale du DPC
L’Agence nationale du DPC fermera ses portes en 2027, mais le financement est garanti pour toute l’année 2026. Profitez-en pour valider votre obligation triennale avant la transition administrative prévue.
Forfaits 2026 pour les orthophonistes libéraux :
• Volume : 14 heures/an.
• Formation Continue (FC) : 43 €/h (frais pédagogiques) + 52 €/h (indemnisation).
• EPP/GDR : 51,60 €/h + 52 €/h.
Conditions de paiement :
• Suivi intégral obligatoire : Toute absence (notamment à la première demi-journée) annule l’indemnisation.
• Inscription sécurisée : Vous devez vous inscrire personnellement sur le portail de l’ANDPC. Confier vos identifiants à un organisme tiers est strictement interdit et vous expose à des sanctions pour complicité de fraude.
Anticipez dès maintenant vos formations pour bénéficier d’un financement maîtrisé avant la disparition de l’Agence.
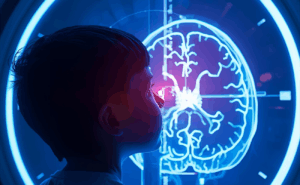
Le raisonnement logique en mathématique : des preuves interventionnelles récentes confirment le rôle causale des compétences logiques sur le développement du nombre
Cet article aborde le rôle causal des compétences d’ordre (ordinalité), confirmé par les preuves interventionnelles récentes (Morsanyi et al., 2024) montrant que l’entraînement à l’ordre numérique et à l’ordre des événements quotidiens (non numérique) entraîne une augmentation importante des compétences mathématiques formelles.
De plus, le raisonnement logique, essentiel pour l’intégration des relations, est altéré chez les enfants ayant des difficultés mathématiques, comme en témoigne la performance réduite dans les inférences transitives et l’activité neurale plus faible observée dans le Sillon Intrapariétal (SIP) lors du traitement de ces relations (Schwartz et al., 2018).