Le raisonnement logique en mathématique : des preuves interventionnelles récentes confirment le rôle causale des compétences logiques sur le développement du nombre
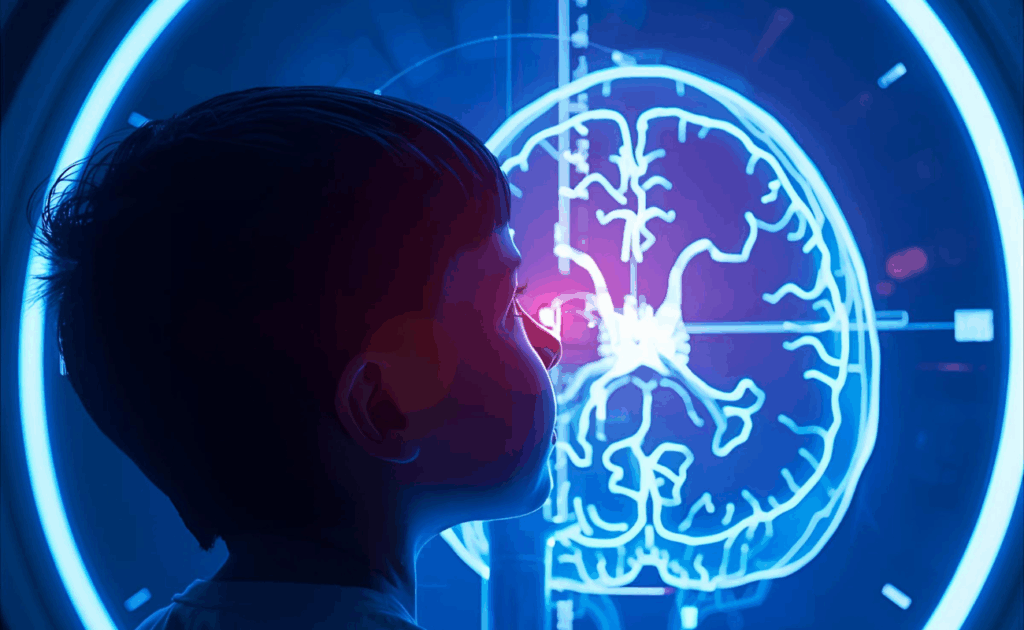
Pendant longtemps, les difficultés d’apprentissage en mathématiques (DAM) — ou dyscalculie — ont été majoritairement expliquées par un déficit isolé du « sens du nombre » inné, une capacité qui permet de discriminer approximativement les quantités (Butterworth et al., 2011 ; Piazza et al., 2010 ; Feigenson et al., 2013). Cependant, une approche plus large et de plus en plus soutenue met en lumière le rôle causal fondamental des compétences d’ordre et de raisonnement logique, suggérant que les DAM sont un trouble hétérogène qui va bien au-delà des capacités numériques de base (Szűcs & Goswami, 2013).
L’idée est simple : maîtriser les mathématiques, ce n’est pas seulement percevoir des quantités ; c’est aussi savoir organiser, déduire et manipuler des relations complexes.
La fin du règne exclusif du « Sens du Nombre »
La perspective traditionnelle, qui associe souvent les déficits neuronaux dans le Sillon Intrapariétal (SIP) à un manque de « sens du nombre » (Ansari, 2008 ; Szűcs & Goswami, 2013), est remise en question.
Les chercheurs reconnaissent désormais que les DAM impliquent souvent des compétences cognitives non numériques, telles que l’attention, l’inhibition et la mémoire de travail (Leibovich et al., 2017 ; Szűcs & Goswami, 2013).
De plus, des théoriciens comme Rafael E. Núñez (2017) rappellent que la cognition quantique (le traitement non symbolique et imprécis de la quantité, biologiquement hérité) est distincte de la cognition numérique (la quantification exacte et symbolique, qui est une construction bio-culturelle dépendante du langage et des pratiques culturelles). Si la cognition quantique fournit les bases (Núñez, 2017), elle ne suffit pas à elle seule pour la pensée numérique exacte, qui nécessite l’abstraction et le raisonnement.
C’est là que les compétences d’ordre et de raisonnement entrent en jeu, car elles fournissent la structure relationnelle nécessaire à la construction des concepts mathématiques.
L’ordinalité : un prédicteur et un facteur causal
Les compétences d’ordre (ou ordinalité) se réfèrent à la capacité à manipuler ou juger l’ordre des éléments. Elles sont de plus en plus reconnues comme des prédicteurs importants de la performance mathématique précoce (Attout et al., 2014 ; Lyons et al., 2014 ; Morsanyi et al., 2018 ; O’Connor et al., 2018), et sont spécifiquement déficientes chez les individus atteints de dyscalculie (Attout & Majerus, 2015 ; Attout et al., 2015 ; Morsanyi et al., 2018).
Le rôle de ces compétences a été confirmé comme étant causal grâce à une étude d’intervention récente (Morsanyi et al., 2024). Cette étude a exploré l’impact de différents types d’entraînement sur les compétences mathématiques formelles chez les jeunes enfants :
- Entraînement à l’ordre numérique symbolique : Il a conduit à une amélioration substantielle des compétences mathématiques formelles.
- Entraînement à l’ordre des événements quotidiens (non numérique) : Il a également entraîné une augmentation importante des compétences mathématiques formelles, avec des effets similaires à l’entraînement numérique (Morsanyi et al., 2024). Ce résultat est particulièrement frappant, car il démontre un effet de transfert éloigné entre un domaine de connaissance non numérique (l’ordre temporel) et les mathématiques.
- Entraînement à la mémoire de travail de l’ordre : Contrairement aux deux autres, cet entraînement n’a montré aucun effet de transfert sur les compétences mathématiques formelles (Morsanyi et al., 2024).
Ces travaux suggèrent que l’amélioration de la capacité d’ordonnancement, même dans un contexte non mathématique (comme juger l’ordre d’activités familières), joue un rôle causal dans le développement des compétences mathématiques précoces (Morsanyi et al., 2024).
De plus, l’ordinalité est tellement fondamentale qu’elle semble servir de médiateur : la performance à la tâche d’ordonnancement numérique médiatise l’effet des compétences de comparaison de magnitude (symbolique et non symbolique) sur la performance mathématique chez les enfants d’âge moyen (Morsanyi et al., 2020 ; Lyons & Beilock, 2011 ; Sasanguie et al., 2017).
Le raisonnement transitif : les difficultés de traitement des relations
Un autre pilier de cette approche par le raisonnement est le raisonnement transitif. C’est la capacité d’intégrer deux relations (par exemple, A est plus grand que B, et B est plus grand que C) pour en déduire une nouvelle (A est plus grand que C).
Ce raisonnement est central dans de nombreux aspects des mathématiques, notamment l’ordinalité, l’inclusion d’ensembles, la mesure, l’algèbre et la preuve déductive en géométrie (Morsanyi et al., 2013 ; Schwartz et al., 2018 ; Ayalon & Even, 2008).
Difficulté de traitement des inférences transitives
Les enfants présentant des DAM montrent une performance réduite dans les inférences transitives (Schwartz et al., 2018). Cette déficience est spécifique à l’intégration des relations et n’est pas due à un problème général de mémoire des détails de l’histoire (Schwartz et al., 2018).
Au niveau cérébral, le Sillon Intrapariétal (SIP), une région souvent associée aux déficits numériques (Kucian et al., 2006), est également impliqué dans le raisonnement transitif chez les adultes et les enfants à développement typique (Goel, 2007 ; Prado et al., 2010, 2011, 2013 ; Mathieu et al., 2014).
Chez les enfants atteints de DAM, les chercheurs ont observé que la différence d’activité dans le SIP lors du traitement des relations transitives (par rapport aux relations non transitives) était non fiable et plus faible que chez leurs pairs, ce qui suggère qu’un déficit dans le traitement neuronal online des relations transitives pourrait contribuer aux difficultés mathématiques (Schwartz et al., 2018).
Les mécanismes de médiation
Le raisonnement transitif ne prédit pas seulement les compétences mathématiques, il le fait par des mécanismes précis (Wong & Morsanyi, 2023 :
- Traitement relationnel : Le raisonnement transitif prédit la connaissance des fractions (Wong & Morsanyi, 2023), qui, en raison de leur nature relationnelle (la magnitude dépend de la relation entre le numérateur et le dénominateur), sont un excellent indicateur de la capacité à traiter les relations (Wong & Morsanyi, 2023). Cette connaissance prédit ensuite la compétence mathématique par la résolution de problèmes arithmétiques.
- Inférence déductive : Le raisonnement transitif prédit également la compréhension du Principe de la relation aux opérandes (Wong & Morsanyi, 2023). Ce principe, qui nécessite une inférence déductive (par exemple, savoir qu’en additionnant deux nombres naturels, le résultat est toujours plus grand que les opérandes), facilite la génération d’équations numériques correctes à partir de problèmes verbaux (Wong & Morsanyi, 2023).
Pourquoi cette approche est cruciale pour la vie quotidienne
L’intérêt de cette approche ne se limite pas aux résultats scolaires. L’étude de Pickering et al. (2025) a montré que des meilleures compétences en raisonnement logique (incluant le raisonnement transitif et conditionnel) et en numératie sont associées à de meilleurs résultats dans les décisions de la vie courante.
Ce lien est observé dans des situations quotidiennes n’impliquant pas d’informations numériques explicites (comme éviter de manquer un train ou de gaspiller de la nourriture). Surtout, cette association demeure significative même après avoir contrôlé les capacités cognitives générales (comme le raisonnement matriciel), l’âge, le sexe et le niveau d’éducation (Pickering et al., 2025).
Ces résultats sont compatibles avec l’hypothèse selon laquelle l’étude des mathématiques développe des compétences de « pensée » générale (raisonnement logique et numératie) qui améliorent les résultats des décisions dans la vie quotidienne (Pickering et al., 2025).
Conclusion : Le raisonnement au cœur de l’intervention
L’approche des difficultés mathématiques axée sur le raisonnement et l’ordre est prometteuse. Elle déplace l’accent d’un déficit purement quantitatif vers un problème d’organisation et de logique.
Pour les cliniciens, cela implique qu’en adoptant une approche basée sur le raisonnement, ils peuvent cibler :
- L’entraînement de l’ordinalité, y compris à travers des séquences non numériques et temporelles (Morsanyi et al., 2024).
- La compréhension des relations (spatial/temporel pour les nombres) et du vocabulaire relationnel (« avant », « après », « suivant ») (Morsanyi et al., 2024 ; Purpura & Reid, 2016).
Les DAM sont complexes et impliquent des déficits dans le traitement des relations et des compétences d’ordre non numériques, au-delà des capacités numériques de base (Schwartz et al., 2018 ; Morsanyi et al., 2024). Reconnaître et traiter ces déficits de raisonnement pourrait être la clé pour une prise en charge plus globale et efficace des troubles de la cognition mathématique (Schwartz et al., 2018 ; Pickering et al., 2025).
Sources :

Rééducation du raisonnement et langage élaboré : Pourquoi choisir la formation Logique et Langage des enfants et adolescents ?
La rééducation du langage élaboré cible les difficultés de raisonnement inférentiel, évitant que l’adolescent ne s’arrête dès que le discours devient trop abstrait. Grâce à l’étayage langagier (Bruner), l’orthophoniste organise le support de communication pour restreindre la complexité des tâches. L’enjeu est de maîtriser le langage informatif pour faciliter le passage crucial des opérations concrètes aux opérations formelles (Tourrette & Guidetti, 2018). Ce programme fournit des outils transférables pour soutenir la compréhension du langage tant sur le versant expressif que réceptif.

DPC 2026 pour les orthophonistes : nouveaux forfaits et transition de l’Agence nationale du DPC
L’Agence nationale du DPC fermera ses portes en 2027, mais le financement est garanti pour toute l’année 2026. Profitez-en pour valider votre obligation triennale avant la transition administrative prévue.
Forfaits 2026 pour les orthophonistes libéraux :
• Volume : 14 heures/an.
• Formation Continue (FC) : 43 €/h (frais pédagogiques) + 52 €/h (indemnisation).
• EPP/GDR : 51,60 €/h + 52 €/h.
Conditions de paiement :
• Suivi intégral obligatoire : Toute absence (notamment à la première demi-journée) annule l’indemnisation.
• Inscription sécurisée : Vous devez vous inscrire personnellement sur le portail de l’ANDPC. Confier vos identifiants à un organisme tiers est strictement interdit et vous expose à des sanctions pour complicité de fraude.
Anticipez dès maintenant vos formations pour bénéficier d’un financement maîtrisé avant la disparition de l’Agence.
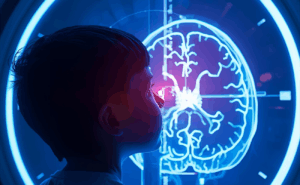
Le raisonnement logique en mathématique : des preuves interventionnelles récentes confirment le rôle causale des compétences logiques sur le développement du nombre
Cet article aborde le rôle causal des compétences d’ordre (ordinalité), confirmé par les preuves interventionnelles récentes (Morsanyi et al., 2024) montrant que l’entraînement à l’ordre numérique et à l’ordre des événements quotidiens (non numérique) entraîne une augmentation importante des compétences mathématiques formelles.
De plus, le raisonnement logique, essentiel pour l’intégration des relations, est altéré chez les enfants ayant des difficultés mathématiques, comme en témoigne la performance réduite dans les inférences transitives et l’activité neurale plus faible observée dans le Sillon Intrapariétal (SIP) lors du traitement de ces relations (Schwartz et al., 2018).


